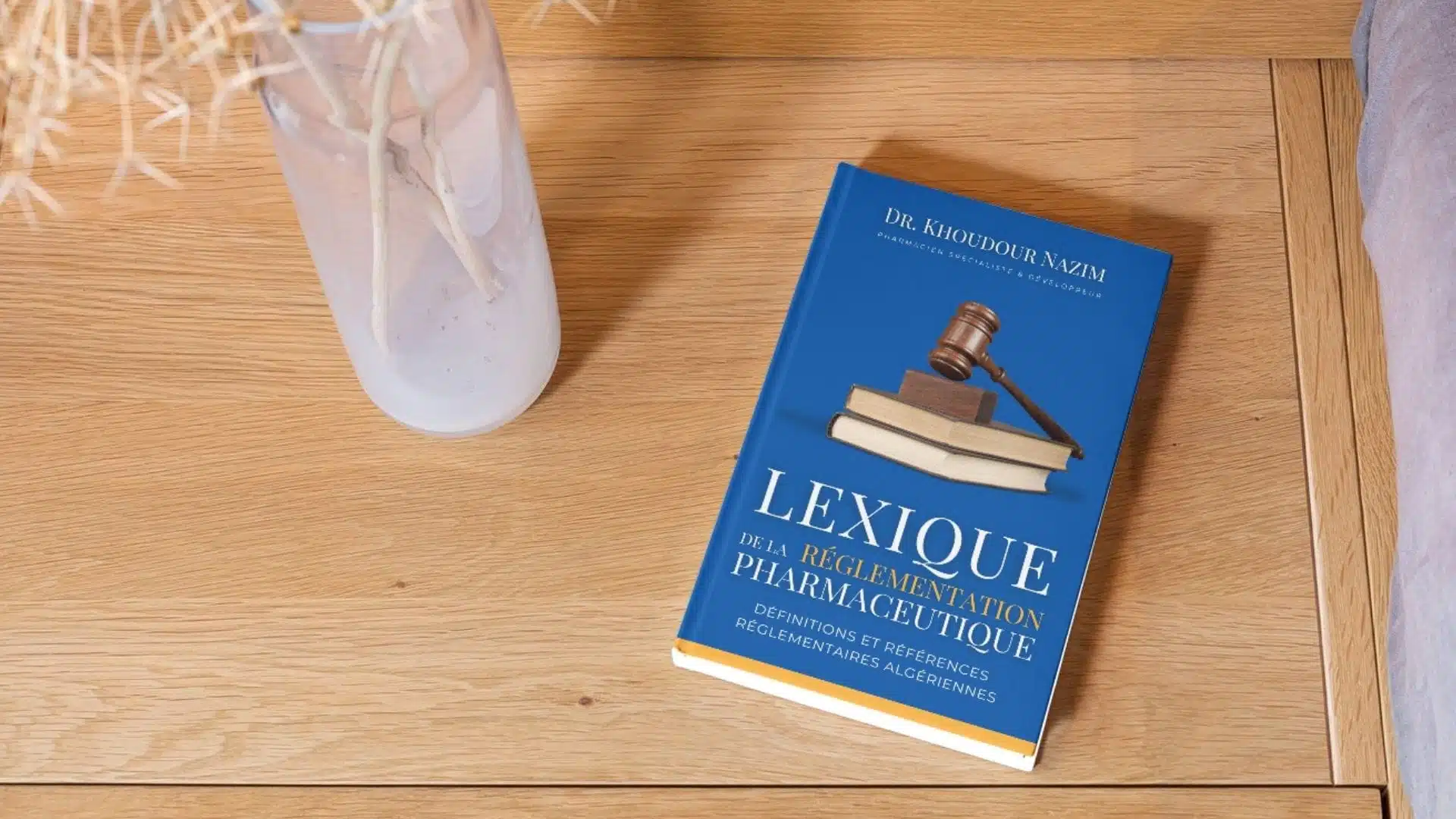L’Algérie, avec ses vastes paysages méditerranéens et sahariens baignés de soleil, présente une image qui contraste fortement avec la réalité biologique de sa population. La principale source de vitamine D pour l’homme est la synthèse cutanée sous l’effet des rayons ultraviolets B (UVB) du soleil. Avec un ensoleillement annuel moyen dépassant les 2600 heures, l’Algérie possède un avantage naturel considérable pour la production de cette vitamine essentielle. Pourtant, les données épidémiologiques convergent pour dresser le portrait d’une nation souffrant d’une carence profonde et généralisée.
L’évolution de la compréhension de la vitamine D : La perception médicale de la vitamine D a radicalement évolué au cours des dernières décennies. Longtemps considérée comme une simple « vitamine des os », elle est aujourd’hui reconnue comme une prohormone stéroïdienne aux effets pléiotropes, régulant l’expression de près de 3 % du génome humain. Son rôle ne se limite plus à l’homéostasie phosphocalcique ; il est désormais établi qu’elle est un modulateur essentiel du système immunitaire, un facteur de protection cardiovasculaire et un élément clé dans la prévention de nombreuses maladies chroniques. Cette nouvelle compréhension souligne les enjeux considérables de la crise de l’hypovitaminose D, dont les conséquences dépassent largement la santé squelettique.
Nous allons dans un premier temps, quantifier l’ampleur de cette épidémie silencieuse en s’appuyant sur des données épidémiologiques locales. Ensuite, nous analyserons la convergence des facteurs comportementaux, culturels, biologiques et alimentaires qui en sont la cause. Enfin, nous examinerons les données du marché des suppléments et l’impact de la pandémie de COVID-19 pour plaider en faveur d’une stratégie de santé publique complète et multi-piliers, englobant la réforme des politiques, l’enrichissement des aliments et l’éducation du public.
1. Quantification de l’hypovitaminose D en Algérie
L’hypovitaminose D n’est pas un problème marginal, mais une crise de santé publique grave et étendue. La convergence des résultats de plusieurs études indépendantes menées dans différentes régions et sur diverses populations dresse un tableau sans équivoque.
a. Synthèse des données de prévalence :
- Blida (Jeunes adultes) : Une étude menée par Djerjdar et al. (2022) dans la région de Blida sur 945 jeunes adultes en bonne santé (18-35 ans) a révélé une prévalence de l’hypovitaminose D (définie par un taux de calcidiol <30 ng/ml) de 92,6 %. Plus inquiétant encore, 65,1 % de ces jeunes étaient en état de carence (taux <20 ng/ml). La puissance de cette étude réside dans sa réalisation durant les mois les plus ensoleillés (mai à août), ce qui démontre que même une exposition solaire maximale théorique ne suffit pas à protéger cette population.
- Constantine (Adultes en bonne santé) : L’étude de Ariba & Slimani (2018) à Constantine sur 84 adultes sains de plus de 25 ans a rapporté une prévalence d’hypovitaminose D de 98 %. L’étude a mis en évidence une sévérité alarmante, avec 57 % des sujets présentant une carence sévère (taux <10 ng/ml), un seuil associé à des conséquences cliniques manifestes comme l’ostéomalacie.
- Alger (Enfants et adolescents) : Le problème s’installe dès le plus jeune âge. Une étude de Ait Idir et al. (2020) sur des enfants de 6 à 12 ans à Alger a trouvé 79,6 % d’hypovitaminose D. Un résumé antérieur du même auteur (2018) sur une cohorte pédiatrique plus large (1-16 ans) avait déjà signalé que 75,3 % des enfants avaient des niveaux inférieurs à 30 ng/ml. Ces chiffres indiquent que les enfants algériens n’atteignent pas un statut vitaminique optimal, compromettant potentiellement leur capital osseux et leur santé future.
- Alger (Population générale) : Un résumé de Himeur et al. (2015) a confirmé la généralisation du problème à Alger, avec des taux de carence élevés dans tous les groupes étudiés : 85 % chez les jeunes adultes (18-30 ans), 93,75 % chez les personnes âgées (40-80 ans) et 86,66 % chez les patientes atteintes d’un cancer du sein.
La consolidation de ces données dans un tableau permet de visualiser l’ampleur et la cohérence de la crise à l’échelle nationale.

La cohérence remarquable de ces résultats, obtenus indépendamment sur une période de près d’une décennie (2015-2022), dans les plus grandes villes du nord de l’Algérie (Alger, Constantine, Blida), sur des groupes démographiques variés et avec des méthodologies de dosage différentes, est un fait saillant. Cette constance élimine la possibilité que ces chiffres soient des artefacts liés à une étude isolée ou à un problème localisé. Elle pointe inexorablement vers des facteurs systémiques puissants, à l’échelle nationale, qui annulent l’avantage géographique du pays. Le problème est donc à la fois chronique, sévère et géographiquement étendu.
b. L’interaction des facteurs limitant la vitamine D
Pour comprendre pourquoi un pays aussi ensoleillé souffre d’une telle carence, il est essentiel d’analyser le système complexe de facteurs qui interagissent pour bloquer la production et la disponibilité de la vitamine D. Ces facteurs ne s’additionnent pas simplement ; ils se multiplient, créant une situation où la carence devient presque inévitable pour une grande partie de la population.
b.1. Facteurs environnementaux et comportementaux
- Urbanisation et modes de vie intérieurs : La transition vers un mode de vie urbain dans les grandes métropoles comme Alger et Constantine a entraîné une diminution drastique du temps passé à l’extérieur. Les emplois de bureau, les loisirs en intérieur (jeux vidéo, télévision) et l’utilisation des transports motorisés réduisent fondamentalement les opportunités d’exposition solaire directe, qui est pourtant la source de 90 % de la vitamine D de l’organisme.
- Températures estivales dissuasives : De plus, les températures souvent caniculaires en été, et de plus en plus fréquemment au printemps, constituent un frein majeur à l’exposition solaire. Pour se protéger de la chaleur intense, la population est naturellement incitée à rester à l’intérieur ou à rechercher l’ombre durant les heures où les rayons UVB sont les plus efficaces (entre 11h et 16h), limitant ainsi paradoxalement la synthèse de vitamine D au moment où le soleil est le plus fort.
- Normes culturelles et habitudes vestimentaires : Le port de vêtements couvrants, notamment le hijab et d’autres formes de voile, est un facteur culturel prédominant et un déterminant majeur du statut en vitamine D. Ces vêtements agissent comme une barrière physique aux rayons UVB. Une méta-analyse a montré que les femmes portant des vêtements couvrants ont un risque 2,28 fois plus élevé de développer une carence en vitamine D. L’étude de Constantine est particulièrement révélatrice : 100 % des femmes de l’échantillon étaient voilées, et parmi elles, 78 % présentaient une carence sévère.
- Utilisation d’écrans solaires : La sensibilisation aux risques de cancer de la peau a conduit à une utilisation accrue des crèmes solaires. Bien que bénéfique pour la prévention des cancers cutanés, cette pratique bloque efficacement les rayons UVB nécessaires à la synthèse de la vitamine D. L’étude de Blida a identifié l’utilisation de la protection solaire comme un facteur de risque significatif , une conclusion corroborée par l’étude de Constantine où 76 % des utilisatrices d’écran solaire présentaient une carence sévère.
- Variation saisonnière : Même dans un pays ensoleillé, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D varie considérablement au cours de l’année. L’angle du soleil en hiver, même à la latitude de l’Algérie (environ 36° Nord), rend les rayons UVB moins efficaces. Une étude algérienne sur des écoliers a clairement démontré cette saisonnalité : les niveaux médians de 25(OH)D chutaient de 71,4 nmol/L en septembre (fin de l’été) à 52,9 nmol/L en mars (fin de l’hiver). Ce creux hivernal aggrave une situation de base déjà précaire.
b.2. Facteurs biologiques
- Phototype de peau : La population algérienne présente majoritairement des phototypes de peau III, IV ou plus foncés selon la classification de Fitzpatrick. La mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, agit comme un écran solaire naturel. Par conséquent, les personnes à la peau plus foncée ont besoin d’une durée d’exposition au soleil beaucoup plus longue pour produire la même quantité de vitamine D qu’une personne à la peau claire. L’étude de Blida a identifié le phototype foncé comme un facteur de risque majeur et indépendant de l’hypovitaminose D.
- Prédisposition génétique (VDBP) : Un concept plus avancé implique l’influence de la génétique. La protéine de liaison à la vitamine D (VDBP, pour Vitamin D Binding Protein) est responsable du transport de la vitamine D dans le sang. Des polymorphismes (variations génétiques) dans le gène GC qui code pour la VDBP, tels que rs4588 et rs7041, sont connus pour être fréquents dans les populations d’Afrique du Nord et du Sahara. Ces variations peuvent affecter l’affinité de liaison de la VDBP et les niveaux de vitamine D circulante, prédisposant ainsi certains individus à des taux plus faibles, indépendamment de leur exposition au soleil. Cela ajoute une couche de risque biologique non modifiable.
- Le facteur de l’adiposité : L’obésité et le surpoids sont des facteurs de risque bien établis. La vitamine D est liposoluble et est séquestrée dans les tissus adipeux. Chez les personnes en surpoids ou obèses, une part importante de la vitamine D synthétisée ou ingérée est piégée dans la graisse et n’est pas biodisponible pour le reste de l’organisme, ce qui entraîne une baisse des taux sériques. Avec des taux élevés de surpoids et d’obésité observés dans les cohortes étudiées (par exemple, 69 % dans l’étude de Constantine ), ce facteur contribue de manière significative au problème.
b.3. Facteurs alimentaires
- Faible apport alimentaire : Le régime alimentaire algérien typique est pauvre en sources naturelles de vitamine D, comme les poissons gras (saumon, maquereau) et les aliments enrichis. La contribution de l’alimentation au statut vitaminique D est donc minime.
- Absence d’enrichissement des aliments : Contrairement à de nombreux pays, y compris des pays de la région comme la Jordanie qui enrichissent des aliments de base tels que la farine , l’Algérie ne dispose pas d’un programme national d’enrichissement obligatoire et généralisé des aliments en vitamine D. Cette absence prive la population d’un filet de sécurité essentiel en matière de santé publique.
- Politique de supplémentation limitée : Le programme national de supplémentation en vitamine D est très restreint, ne ciblant que les nourrissons à l’âge de 1 et 6 mois avec des doses de charge. Il n’existe pas de recommandations systématiques pour les autres groupes à haut risque clairement identifiés par les études locales : adolescents, femmes voilées, personnes âgées ou obèses.
L’analyse de ces facteurs révèle une convergence systémique. Il ne s’agit pas de risques isolés, mais d’une cascade d’effets qui se renforcent mutuellement. Prenons l’exemple d’une jeune femme urbaine en Algérie : elle peut avoir une prédisposition génétique à des niveaux plus bas de vitamine D (polymorphisme VDBP) et un phototype de peau qui nécessite plus de soleil. Son travail de bureau et son mode de vie urbain limitent son exposition. Lorsqu’elle sort, ses vêtements couvrants bloquent les UVB. Si elle est en surpoids, la vitamine D qu’elle parvient à obtenir est séquestrée dans ses tissus adipeux. Son alimentation est pauvre en vitamine D et les aliments ne sont pas enrichis. Enfin, en hiver, les rayons du soleil sont de toute façon trop faibles pour une synthèse efficace. Cet individu n’a pratiquement aucune voie pour atteindre un statut vitaminique D suffisant. C’est ce faisceau systémique, et non une cause unique, qui est au cœur du paradoxe algérien.
2. Signaux du marché : Analyse des ventes de suppléments de vitamine D en Algérie (2019-2024)
L’analyse des données de vente de suppléments de vitamine D offre un aperçu précieux de la manière dont le système de santé et les consommateurs réagissent à cette crise de carence. Les chiffres de vente du cholécalciférol, la forme la plus courante de supplément de vitamine D3, agissent comme un indicateur indirect de la prévalence diagnostiquée et traitée.
a. Présentation des données :
Les données sur les ventes unitaires de cholécalciférol en Algérie de 2019 à 2024 sont présentées ci-dessous.


b. Analyse du volume et des tendances des ventes :
- Confirmation d’une forte demande : Les volumes de vente absolus sont considérables, avec plus de 17 millions d’unités vendues en 2019 et un total de plus de 72 millions sur la période. Ce volume élevé est un signal clair du marché : l’hypovitaminose D est une condition largement diagnostiquée par les médecins algériens et traitée activement par la prescription de suppléments. Ces chiffres corroborent directement les données de prévalence élevées présentées précédemment.
- Déconstruction de la tendance (2019-2024) : L’hypothèse selon laquelle la pandémie de COVID-19 aurait provoqué une simple hausse des ventes à partir de 2020 est infirmée par les données. La tendance est plus complexe : Un pic en 2019 : L’année 2019 représente le point culminant des ventes sur la période, indiquant une forte prise de conscience et une pratique de prescription déjà bien installée avant la pandémie. Une chute significative en 2020 : Contrairement à l’attente d’une hausse, les ventes ont chuté de près de 20 % en 2020. Un rebond modeste en 2021 : Une légère reprise est observée en 2021, ce qui suggère un effet retard de la prise de conscience liée à la pandémie. Une tendance à la baisse depuis 2022 : Les ventes ont de nouveau diminué en 2022, 2023 et sur la partie de 2024, ce qui pourrait indiquer des changements dans le marché, des problèmes d’approvisionnement ou une évolution des pratiques de prescription.
c. Mise en contexte du marché algérien :
Ces chiffres doivent être interprétés dans le contexte plus large du marché pharmaceutique. Le marché mondial des compléments nutritionnels connaît une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté entre 7,3 % et 7,6 %. Le marché de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) est également en forte expansion. Le marché pharmaceutique de détail en Algérie a connu une croissance de 2,3 % au premier trimestre 2024, avec une montée en puissance des acteurs locaux. Les données pour une seule molécule (cholécalciférol) pourraient ne pas refléter l’ensemble du marché des suppléments de vitamine D, qui pourrait se déplacer vers des produits combinés (par exemple, vitamine D + calcium) ou des formes non médicamenteuses (compléments alimentaires) non incluses dans ces chiffres. De plus, l’Algérie manque d’un cadre réglementaire strict pour les compléments alimentaires, ce qui peut entraîner une volatilité du marché et la prolifération de produits non réglementés qui échappent à ce type de statistiques.
La chute brutale des ventes en 2020, année du début de la pandémie, est contre-intuitive si l’on ne considère que la demande des consommateurs. Cet événement suggère que d’autres forces, plus puissantes, étaient à l’œuvre. La pandémie a provoqué des confinements stricts, une saturation des systèmes de santé et une perturbation mondiale des chaînes d’approvisionnement. Les patients algériens ont probablement eu un accès réduit aux consultations médicales pour des bilans de routine et l’obtention de prescriptions. Les pharmacies elles-mêmes ont pu faire face à des ruptures de stock. Par conséquent, même si l’intérêt pour la vitamine D augmentait, la capacité à l’acheter par les canaux officiels a probablement diminué. Le chiffre de 2020 est donc plus probablement le reflet d’un choc systémique sur l’offre et l’accès que d’un simple signal de demande.
3. Que faire pour en venir à bout ?
L’analyse approfondie de la prévalence, des causes et des indicateurs de marché de l’hypovitaminose D en Algérie doit maintenant laisser place à des recommandations concrètes et réalisables. Passer du constat à l’action nécessite un cadre stratégique clair, destiné aux décideurs politiques, aux autorités sanitaires et à l’industrie pharmaceutique, voire, agroalimentaire.
a. Le coût de l’inaction
Avant de proposer des solutions, il est crucial de souligner le coût de l’inaction. L’hypovitaminose D n’est pas une condition bénigne ; elle engendre des coûts directs et indirects considérables pour le système de santé et la société.
- Fardeau de l’ostéoporose : La conséquence la plus directe et la mieux documentée de la carence chronique en vitamine D est l’ostéoporose. Au niveau mondial, le coût des fractures de fragilité se chiffre en milliards de dollars chaque année dans les pays développés, sans même compter les coûts indirects liés à l’invalidité et à la perte de productivité. Les études algériennes montrent des taux élevés d’hyperparathyroïdie secondaire (une réponse hormonale à la baisse du calcium due à la carence en vitamine D), qui est un précurseur direct de la déminéralisation osseuse et de l’ostéoporose. Laisser la population dans un état de carence généralisée prépare une future épidémie de fractures de fragilité, avec un fardeau économique insoutenable pour le système de santé.
- Risques de maladies chroniques : Au-delà de l’os, la carence en vitamine D est un facteur de risque reconnu pour d’autres maladies chroniques coûteuses. Le diabète de type 2, dont la prévalence est en forte augmentation en Algérie, est l’une d’entre elles. Des études montrent une association significative entre un faible statut en vitamine D et un risque accru de diabète de type 2, potentiellement via des mécanismes liés à la résistance à l’insuline et à l’inflammation.
b. Stratégie de lutte contre l’hypovitaminose D
b.1. Réforme de la politique nationale de supplémentation
- La lacune actuelle : La politique de supplémentation actuelle est manifestement insuffisante. En ne ciblant que les nourrissons à 1 et 6 mois, elle laisse la quasi-totalité de la population, y compris les groupes à très haut risque, sans aucune protection ni recommandation officielle.
- La recommandation : Il est impératif d’élargir le programme national de supplémentation sur la base des preuves scientifiques et des données épidémiologiques locales. Des directives claires doivent être établies pour les groupes à risque identifiés dans les études épdémiologiques : Toutes les femmes en âge de procréer, avec une attention particulière pour celles qui portent des vêtements couvrants. Les enfants d’âge scolaire et les adolescents, pour garantir l’atteinte d’un pic de masse osseuse optimal. Les personnes âgées et les femmes ménopausées, pour la prévention primaire et secondaire de l’ostéoporose. Les personnes en surpoids ou obèses, en raison de la séquestration de la vitamine D dans les tissus adipeux.
Les dosages recommandés devraient s’aligner sur les directives internationales, visant un apport quotidien de 800 à 2000 UI, selon le groupe de risque et le niveau de carence de base.
b.2. Enrichissement alimentaire national
- Le modèle jordanien : La Jordanie offre un cas d’étude pertinent pour une politique d’enrichissement. Le pays a mis en place un programme national d’enrichissement de la farine de blé (de type « Mowahad », un produit de base largement consommé) dès 2002, initialement avec du fer et de l’acide folique, puis étendu à la vitamine D en 2010 en réponse aux taux de carence élevés.
- Impact et limites : Bien que ce programme soit un modèle en termes de mise en œuvre, des données récentes montrent que la carence en vitamine D reste un problème en Jordanie. Cela suggère que l’enrichissement seul n’est pas une solution miracle, mais qu’il constitue une composante essentielle et indispensable d’une stratégie plus large. Il agit comme un filet de sécurité, améliorant le statut de base de l’ensemble de la population de manière passive et équitable.
- La recommandation pour l’Algérie : Il est fortement recommandé d’envisager de toute urgence un programme similaire en Algérie. L’enrichissement d’un aliment de base largement consommé, comme la farine de blé ou le lait, est le moyen le plus efficace et le plus équitable d’améliorer le statut en vitamine D de l’ensemble de la population, en particulier des plus vulnérables.
b.3. Éducation et autonomisation du public
- Le manque d’information : L’étude de Blida a révélé que le manque de connaissances sur la vitamine D était l’un des principaux facteurs de risque de carence. Le public n’est souvent pas conscient du paradoxe : vivre dans un pays ensoleillé ne garantit pas un statut suffisant en vitamine D.
- La recommandation : Une campagne nationale de santé publique, diffusée sur de multiples canaux, est nécessaire pour combler ce fossé. Les messages doivent être clairs, simples et culturellement adaptés, et porter sur : L’importance de la vitamine D pour la santé globale (immunité, muscles, prévention des maladies), et pas seulement pour les os. L’explication du paradoxe : pourquoi la supplémentation est nécessaire même dans un pays ensoleillé, en raison des modes de vie et des habitudes vestimentaires. Des conseils sur les pratiques d’exposition solaire sûres et efficaces (par exemple, 15 à 20 minutes sur les bras et les jambes aux heures de midi, lorsque cela est possible et socialement acceptable). L’information sur les rares sources alimentaires de vitamine D et la promotion des aliments enrichis lorsqu’ils seront disponibles.
Références :
- Épidémiologie de l’hypovitaminose D chez une population jeune adulte en bonne santé apparente en Algérie (Djerjdar et al., 2022)
- La fréquence de l’hypovitaminose D chez des sujets sains de la wilaya de Constantine (Ariba & Slimani, 2018)
- Principaux facteurs de l’hypovitaminose D chez des enfants âgés de 6 à 12 ans non supplémentés dans un milieu urbain à Alger (Ait Idir et al., 2020)
- La population algéroise et la vitamine D (Himeur et al., 2015)