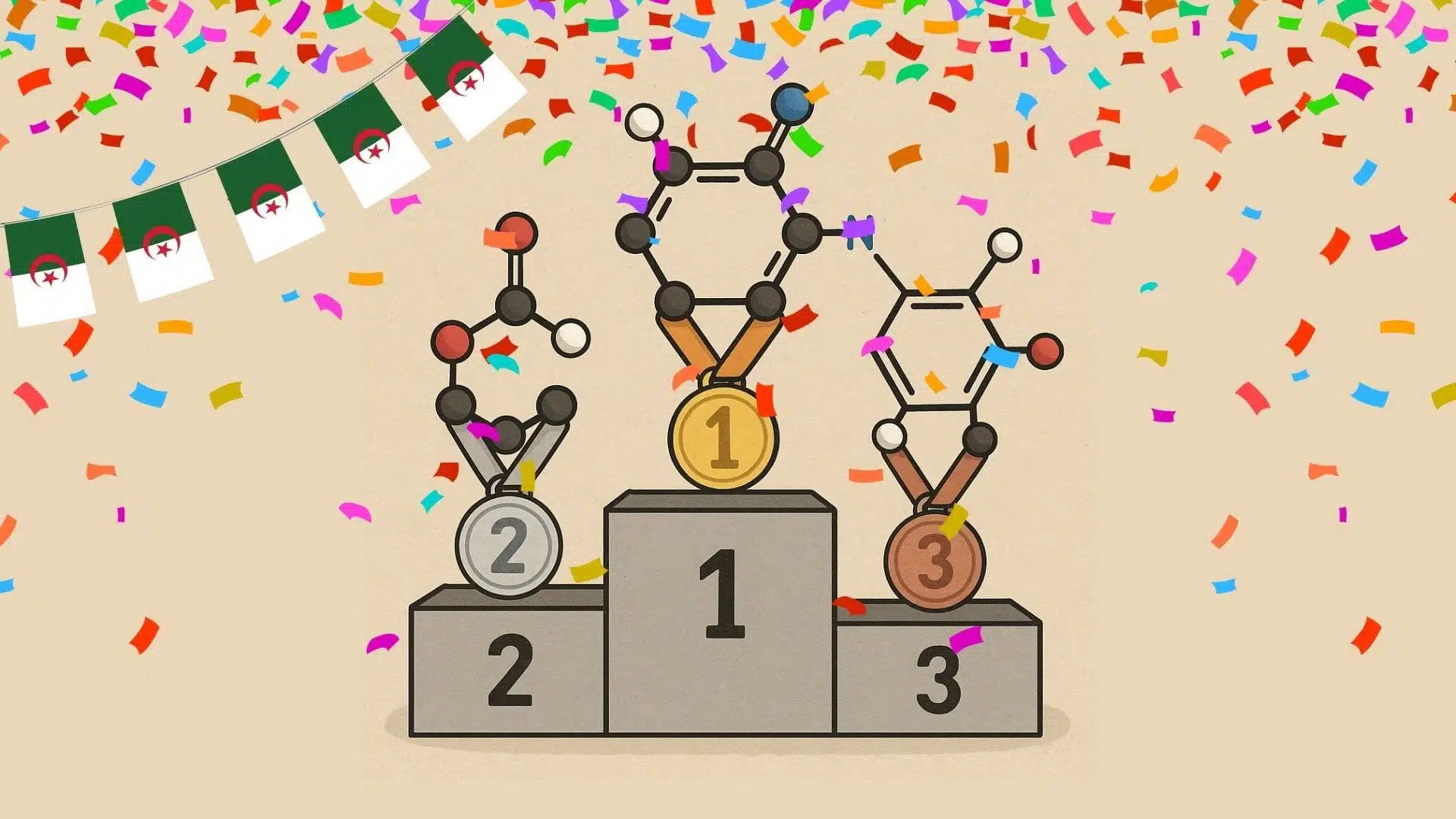En Algérie, la promotion des produits pharmaceutiques obéit à une réglementation stricte. Encadrée par la loi n°18-11 relative à la santé (2018), le décret exécutif n°92-286 (1992), et par la note d’orientation de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (2022), la publicité des produits pharmaceutiques est soumise à des règles précises. Objectif : protéger les citoyens contre les dérives commerciales tout en assurant un usage rationnel du médicament.
Au sens du présent article, on entend par produits pharmaceutiques, les médicaments, les produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les matières premières à usage pharmaceutique, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que tout autre produit utilisé en médecine humaine.
On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’être humain à des fins médicales telles que le diagnostic, la prévention, la surveillance, le traitement ou l’atténuation d’une maladie ou d’une blessure.
Enfin, par produits de santé on entend l’ensemble formé par les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux.
1. Quelle est la différence entre information scientifique et promotion médicale ?
Premier point fondamental : la législation opère une distinction nette entre l’information scientifique et la promotion médicale. L’information scientifique, obligatoire selon l’article 235 de la loi de santé, consiste à transmettre des données rigoureuses et vérifiables sur un produit pharmaceutique— sa formule, ses indications, ses effets secondaires, ses résultats cliniques — dans le but d’éclairer les professionnels de santé et les usagers. Elle doit obligatoirement mentionner la dénomination commune internationale (DCI) du produit et reposer sur les données les plus récentes de la recherche.
À l’inverse, la publicité a une vocation promotionnelle : elle vise à encourager la prescription ou la délivrance d’un produit. Et à ce titre, elle est strictement encadrée — voire interdite — selon le public ciblé.
Exemples concrets :
Information scientifique :
- Une fiche destinée aux professionnels de santé mentionnant : « La metformine (DCI) est un antidiabétique oral indiqué dans le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte, notamment en cas de surcharge pondérale, lorsque la glycémie ne peut être contrôlée par le régime seul. Les effets secondaires fréquents incluent des troubles gastro-intestinaux. »
- Un article publié dans une revue médicale présentant les résultats d’un essai clinique sur l’efficacité d’un nouvel antihypertenseur.
Promotion médicale :
- Une affiche ou une brochure portant un slogan comme : « Faites confiance à Glucophage® pour stabiliser vos patients ! Plus efficace, mieux toléré ! »
· Une présentation commerciale faite par un représentant de laboratoire mettant en avant un médicament sous son nom de marque, en insistant sur ses avantages par rapport aux produits concurrents.
2. A l’adresse de qui la promotion médicale est autorisée ?
La publicité pour les produits pharmaceutiques est autorisée exclusivement à destination des professionnels de santé : médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, etc. Mais même dans ce cadre, elle doit respecter plusieurs conditions cumulatives.
Selon l’article 237 de la loi sur la santé, la publicité :
- doit porter uniquement sur des produits pharmaceutiques enregistrés auprès de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP),
- est soumise à une autorisation préalable de cette même agence (appelée visa publicitaire),
- doit être objective, équilibrée, non trompeuse, et respecter la décision d’enregistrement ainsi que les stratégies thérapeutiques en vigueur.
Le caractère équilibré signifie que la publicité ne doit pas minimiser ou omettre les effets indésirables ; elle doit présenter les bénéfices et les risques de manière équitable, sur la base de données validées.
Elle est également assujettie au paiement d’une redevance fixée à 60 000 dinars.
Les supports utilisés — brochures, e-mails, affiches, dépliants, etc. — doivent impérativement inclure :
- les données du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP),
- une incitation claire à déclarer les effets indésirables, avec les coordonnées du Centre National de Pharmacovigilance.
Le pharmacien responsable de l’information scientifique joue un rôle clé : il est tenu de veiller au respect de toutes ces obligations. C’est lui qui garantit que l’ensemble du contenu diffusé est conforme à la réglementation en vigueur.
3. Et le grand public ??
La réglementation algérienne en matière de promotion médicale ne laisse aucune place à l’interprétation : la promotion des produits pharmaceutiques auprès du grand public est strictement interdite. L’article 237 de la loi n°18-11 relative à la santé le formule sans détour : « la publicité pour les produits pharmaceutiques et la promotion en direction du public sont interdites quels que soient les moyens d’information utilisés ».
Cette interdiction s’applique à tous les canaux de communication, y compris les plus récents comme les réseaux sociaux, où les entorses à la réglementation sont devenues fréquentes. Certains laboratoires, officines ou influenceurs tentent de contourner la loi en publiant des contenus présentés comme « informatifs » mais qui relèvent en réalité d’une promotion déguisée : vidéos vantant les effets d’un produit, publications sponsorisées, témoignages d’utilisateurs, ou encore pages entières dédiées à des médicaments en vente libre. Ces pratiques sont illégales, quelles que soient la forme ou l’intention affichée.
Au-delà de l’aspect réglementaire, cette interdiction repose sur un enjeu de santé publique. En exposant directement le public à des messages promotionnels, on risque de banaliser l’usage du médicament, d’encourager l’automédication, ou de détourner l’attention des patients des recommandations professionnelles. Le médicament, même en vente libre (OTC), n’est pas un produit anodin : il implique un usage raisonné, adapté à chaque situation clinique, et prescrit ou conseillé dans un cadre médical.
La loi réaffirme donc un principe essentiel : seuls les professionnels de santé sont habilités à orienter les choix thérapeutiques des patients, sur la base de critères scientifiques, cliniques et individuels, et non sur des arguments publicitaires. En ce sens, l’interdiction de la publicité grand public n’est pas une simple contrainte réglementaire : c’est une garantie de protection des citoyens face aux impératifs marchands, au service de leur santé.
4. Quelles règles pour un message promotionnel rigoureux ?
Même dans les supports autorisés, le contenu du message promotionnel est scruté à la loupe :
- Les allégations thérapeutiques doivent reposer sur des études publiées, révisées par des pairs, méthodologiquement solides.
- Il est interdit d’utiliser des formulations absolues telles que « sans danger », « 100 % efficace », « non toxique » ou « idéal ».
- Les résultats relatifs (ex. : « réduction de 40 % du risque ») doivent être accompagnés d’éléments absolus et clairs (ex. : nombre de patients à traiter, réduction réelle).
- Toute citation de publication scientifique doit être fidèle et documentée, sans omettre les données négatives.
Même les graphismes et infographies doivent respecter des règles strictes : axes bien définis, absence d’exagération visuelle, mention explicite de la signification statistique, etc…

Exemple d’une affiche trompeuse : Cette publicité pour Lipitor (atorvastatine calcium) met en avant une réduction du risque de crise cardiaque de 36%. Ce chiffre représente la réduction du risque relatif, ce qui peut sembler très impressionnant.
Cependant, en examinant les données indiquées en petits caractères au bas de la publicité, on découvre que la réduction du risque absolu est beaucoup plus modeste : dans l’étude clinique mentionnée, 3% des patients prenant un placebo ont eu une crise cardiaque, contre 2% des patients prenant Lipitor. La réduction du risque absolu n’est donc que de 1 point de pourcentage (3% – 2% = 1%).
Cette distinction entre risque relatif et risque absolu est cruciale pour une bonne compréhension des bénéfices réels d’un médicament. La présentation exclusive de la réduction du risque relatif (36%) sans mettre en évidence la réduction du risque absolu (1%) peut potentiellement induire en erreur les patients et les médecins sur l’ampleur du bénéfice clinique.
Pour une prise de décision médicale éclairée, il est essentiel que les communications scientifiques et promotionnelles précisent clairement si les réductions de risque mentionnées sont relatives ou absolues, et idéalement qu’elles présentent les deux valeurs côte à côte. Les pratiques promotionnelles doivent non seulement respecter la législation, mais aussi l’éthique médicale. À ce titre :
- la sécurité du patient doit primer sur toute autre considération ;
- les supports doivent être validés en amont ;
- le visa publicitaire est obligatoire et son numéro doit figurer clairement sur le matériel diffusé ;
- toute allégation doit pouvoir être vérifiée à la demande par les autorités de santé ou les professionnels.
5. Qui peut faire de la promotion médicale ?
Selon la loi de santé, seules les entités suivantes sont habilitées à produire et diffuser de la publicité :
· Les établissements pharmaceutiques de fabrication : sont autorisés à assurer la promotion des produits pharmaceutiques qu’ils fabriquent.
· Les sociétés spécialisées dans la promotion médicale : Ces sociétés sont autorisées à faire la publicité pour les produits pharmaceutiques enregistrés, dans le cadre de prestations effectuées pour le compte d’autres établissements pharmaceutiques.
Les institutions liées à la santé publique, la recherche et la formation, ainsi que certaines associations sociales ou scientifiques peuvent diffuser de l’information scientifique et non promotionnelle à des fins éducatives.
6. Et les dispositifs médicaux dans tout ça ?
Contrairement aux produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux (DM) — pansements, prothèses, matériels de diagnostic, etc. — ne font pas l’objet d’un encadrement spécifique en matière de promotion médicale dans la législation actuelle. La loi n°18-11 relative à la santé n’aborde pas leur promotion, et aucune disposition réglementaire claire n’en précise les modalités.
Ce vide juridique laisse place à des pratiques promotionnelles disparates, certains dispositifs étant mis en avant librement sur Internet ou en officine, y compris auprès du grand public, souvent de manière ambiguë. Pourtant, l’absence de réglementation spécifique ne saurait exonérer les acteurs du secteur — et en particulier le pharmacien directeur technique — de leur devoir d’éthique. Celui-ci reste tenu de veiller à ce que l’information diffusée soit loyale, non trompeuse, et conforme aux principes déontologiques qui encadrent la profession. »
Ce vide juridique contraste avec les standards internationaux, où les DM sont soumis à des régulations précises, notamment pour garantir la transparence des allégations, la validation scientifique des bénéfices, et la protection des usagers.
Il devient donc urgent que les autorités de santé en charge des produits de santé clarifient le statut des dispositifs médicaux en matière de promotion, afin d’assurer une cohérence globale dans la communication sur les produits de santé et d’éviter les dérives.
Pour aller plus loin :